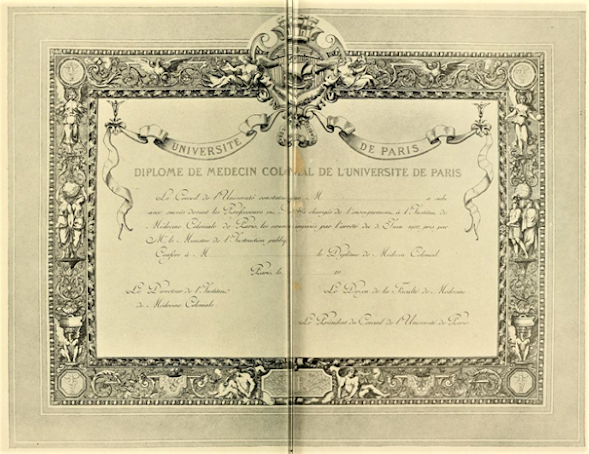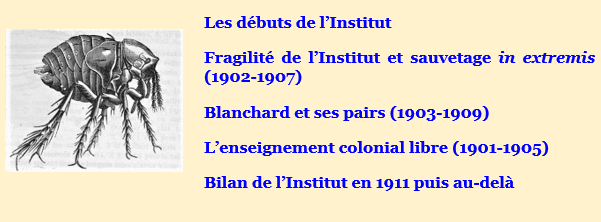
Les débuts de l’Institut
L’enfantement de l’Institut fut difficile et il fallut attendre trois ans après l’initiative conjuguée de l’Union coloniale et de Blanchard pour que les cours commencent, soit en octobre 19021.
Comme toutes celles qui suivront, cette unique session annuelle dura 3 mois, d’octobre à décembre. 30 élèves s'étaient inscrits, et 20 se présentèrent aux cours: médecins diplômés (12), internes des hôpitaux (3) et étudiants de 5e année (5). Huit étaient étrangers. L’Institut ne disposant pas de locaux propres, les cours et les démonstrations avaient lieu dans les salles appartenant aux trois chaires d’enseignement impliquées, avec 6 enseignants.
Un enseignement complet sur les maladies et l’hygiène tropicales y était dispensé, incluant la parasitologie, par Blanchard, la bactériologie, l’ophtalmologie, la pathologie exotique, la dermatologie et même la chirurgie. Environ 1/3 des 120 leçons (théoriques et pratiques) étaient consacrées à la parasitologie, les deux autres disciplines majeures étant la bactériologie (Pr A. Chantemesse2) et la pathologie exotique (Agrégé R. Würtz3).
L’enseignement clinique était modeste. L’institut disposait de 12 lits dans la salle de médecine de l’hôpital de l’Association des dames françaises pendant les trois mois de l’instruction. Pendant cette période restreinte la salle était placée sous la responsabilité d’un chef de service de la faculté de médecine, sous réserve de ne faire admettre aucun malade contagieux.4
Le budget était rattaché à celui de la Faculté de médecine, l’institut étant doté d’un conseil d’administration de 6 personnes. À sa tête: le nouveau Doyen M. Debove (Président) et l’ex-doyen P. Brouardel (Vice-Président). Blanchard en était membre, au même titre que trois collègues: A. Proust (le père de l’écrivain), pour la chaire d’hygiène, A. Le Dentu, celle de clinique chirurgicale et A. Chantemesse, celle de pathologie expérimentale et comparée. Dans un tel schéma d’organisation Blanchard n’avait pas de pouvoir décisionnel. Son rôle restait limité à l’enseignement de sa spécialité.
À l’issue de la première session 15 élèves reçurent le diplôme à l’occasion d’une cérémonie en présence du recteur de l’Université. C’est Würtz qui lut le rapport d’activités, ce qui confirme que Blanchard n’exerçait pas la responsabilité de l’institut.
La deuxième session, qui démarre en octobre 1903, admit 25 élèves, dont environ 50% d’étrangers et une prédominance sud-américaine. Elle fut marquée par la visite de Blanchard et d’une délégation de d’élèves à l’Ecole de médecine tropicale de Londres (28-29 décembre 1903). Blanchard put y rencontrer ses collègues de l’école de Londres, notamment L. Sambon, P. Manson, J. Low, et J. Cantlie.
Ces premiers évènements relatifs au nouvel institut ont évidemment ont fait l’objet d’une large publicité dans les Archives de parasitologie, le périodique scientifique que Blanchard dirigeait, comme l’illustrent les deux photos suivantes : la première promotion de 1902 et le diplôme.
Première session de l’Institut de médecine coloniale de Paris (1902).

Le diplôme de médecin colonial de l’Université de Paris (Arch. parasitol, 1904, IX)
Fragilité de l’Institut et sauvetage in extremis (1902-1907)
Très vite, des critiques extérieures s’élevèrent sur le manque d’ambition de l’Institut et le peu d’implication de l’État et des parties prenantes dans son financement. On relèvera en particulier celles d’un article du British Medical Journal parue en 1903 à la suite d’une visite d’experts britanniques et qui se demande, en faisant allusion à l’ex-Doyen Brouardel, pourquoi on a mis à la tête de l’institut un homme qui n’a aucune compétence dans le domaine des maladies tropicales. Une traduction de cet article anglais a été publiée dans les Archives de parasitologie, commentaires partagés par Blanchard, ravi d’entendre critiquer un homme qui n’avait eu de cesse de briser ses initiatives5.
Blanchard omet en revanche de rapporter le dépôt en 1905, par le député Émile Flourens, ex-ministre des Affaires étrangères, d’une proposition de loi portant sur la création d’une chaire de médecine coloniale à la faculté de de médecine de Paris. La Quinzaine coloniale s’en fit l’écho dans son numéro du 25 décembre de la même année. Il y est dénoncé l’insuffisance de formation et d’expertise scientifique pour la médecine tropicale civile en France comparée aux modèles anglais, ceci au moment-même où la troisième promotion de l’IMC est en cours de formation. Puis vient une allusion perfide à l’Institut lui-même :
« Il existe bien, il est vrai, un institut colonial (sic), mais cet institut, dû seulement à la plus louable initiative privée, manque des ressources suffisantes pour remplir la mission qu’il s’est assignée et surtout son enseignement est dépourvu de toute sanction »6
Cette proposition de loi n’a pas eu de suite mais elle montre que l’opinion était dubitative quant à la capacité de l’Institut à remplir pleinement son rôle.
Blanchard était lucide sur les fragilités de l’Institut. Ainsi en 1907 lance-t-il un cri d’alarme alors que le Gouverneur général d’Indochine vient d’annoncer la fin de son soutien financier de 30.000 F annuels7. L’unique crédit extérieur prenait fin et cela était anticipable puisque la convention initiale portait sur 5 années seulement. Blanchard ne retient plus alors son courroux contre Brouardel, mort en juillet 1906, et à qui il reproche de n’avoir pas activement recherché des soutiens financiers. Au passage, il s’attribue l’initiative de la création de l’Institut et rappelle qu'il avait obtenu le soutien de Paul Doumer, Gouverneur-Général de l’Indochine :
« Chacun sait que cette utile institution a été fondée par mes soins, malgré des difficultés qui, deux années durant, en ont retardé l'éclosion et dont la moindre n'a pas été l'inertie, le plus décourageant des obstacles. La création une fois réalisée, M. Brouardel, alors descendu du décanat, se fit attribuer la direction de l'I.M.C. On pouvait espérer que les loisirs dont il disposait alors lui permettraient de prouver sa sollicitude à la nouvelle institution en lui attirant des subsides, en faisant pour elle une propagande féconde, en parant à ses conditions précaires d'existence, en intéressant à son sort les pouvoirs publics, l'Université, les diverses colonies et pays de protectorat, les grandes sociétés de colonisation, de navigation, de banque et d'affaires coloniales, etc., ainsi que les Mécènes dont notre pays n'est pas encore totalement dépourvu et qui, trop souvent, ne savent pas employer leur argent de la façon la plus judicieuse et la plus profitable à l'intérêt général. Par ses vastes relations, sa grande notoriété, les hautes fonctions dont il avait été si longtemps investi, M. Brouardel eut pu faire tout cela ; lui seul avait qualité pour le faire. Or, on ne saurait citer la moindre subvention acquise par ses soins à l'I.M.C., pas même le moindre appui moral gagné à l'institution. […] A la mort du professeur Brouardel, l'Institut de Médecine coloniale n'était donc pas plus avancé que le jour même de sa fondation ; il était même moins avancé, puisqu'il avait derrière lui quatre années entièrement perdues, au point de vue financier s'entend, et n'avait plus l'existence assurée que pour un an. »
Blanchard se dédouanait un peu vite de ses propres responsabilités : malgré son entregent et son prestige personnels il n’était pas parvenu lui-même à conquérir de nouveaux mécènes durant ces cinq années. On imagine pourtant qu’il continuait de cultiver ses relations à l’Union coloniale dont il était très proche.
En vérité le projet d’Institut parisien ne séduisait pas les grands soutiens potentiels qu’auraient pu être les armateurs et les diverses entreprises coloniales.
On apprend l’année suivante que le pire fut évité, grâce à la promesse de l’Indochine de renouveler finalement son soutien, mais à hauteur de 15.000 F seulement. A ce montant dérisoire s’ajoutèrent 500 F du ministère des Colonies, autant dire presque rien8. On apprend à l’occasion que Brouardel fut remplacé à la tête du Conseil d’administration, non pas par Blanchard mais par A. Le Dentu, en sa qualité de doyen d’âge des professeurs associés l’Institut ! C’est dire que Blanchard, pour des raisons obscures, ne faisait pas l’unanimité au sein de l’Université malgré son rôle essentiel dans la création et dans le rayonnement de l’Institut à l'extérieur .
C'est bien lui pourtant qui représente l'Institut à la grande exposition coloniale de Marseille de 19069 où il est président de la 7e section (Hygiène et élevage). Mais, ainsi que le précise le rapport d’activités, il est là « à titre personnel, en tant que fondateur de l’Institut, et non pas en nom collectif ». À cette occasion, il présente l’ensemble de ses propres matériels d’enseignements ainsi que quelques spécimens de ses collections de mouches et moustiques. Le compte rendu de l’exposition détaille les activités de Blanchard sans faire aucune allusion aux autres enseignements de l’Institut (Annexe 3). À défaut d’être un vrai lieu de pouvoir pour lui, l’Institut est donc une vitrine professionnelle et le lieu d’où rayonne son prestige de professeur.
Blanchard et ses pairs (1903-1909)
Les débuts de l’Institut furent l’occasion de plusieurs conflits entre Blanchard et des spécialistes reconnus de médecine tropicale, notamment Laveran (Institut Pasteur), Chantemesse (Faculté de médecine de Paris et collègue direct à l’IMC), et Giard (Faculté de médecine de Lille, puis Université de Paris). On a l’impression que Blanchard, pour renforcer sa légitimité dans ce champ très compétitif, transgresse quelque peu les règles éthiques en matière de publication scientifique. Il s’attribue en effet des découvertes que ses pairs lui contestent publiquement, à la Société de Biologie ou à l’Académie de médecine (voir l’Annexe 2 pour le détail de ces incidents qui se déroulent en 1903, une année mouvementée pour Blanchard).
Si le monde des spécialistes de médecine coloniale (dans le corps de santé coloniale et à l’Institut Pasteur notamment) n’est pas très perméable à l’influence de Blanchard, le lobby colonial français, en revanche, ne lui ménage pas sa reconnaissance : membre de l’Union coloniale dès 1900, il devient en 1904 président de la 7e section (Médecine et Hygiène) du Congrès colonial français, fonction qu’il conservera à tous les congrès annuels subséquents non sans placer dans la section une partie de ses collaborateurs directs. En 1905, il devient même vice-président de l’Union coloniale, fonction très politique qu’il partage avec des députés, des anciens ministres ou gouverneurs de colonies10.
On note dans la même période une certaine complaisance de Blanchard à rapporter des louanges à sa propre gloire provenant de collègues étrangers, ceci dans son journal, les Archives de parasitologie. Par exemple, celles d’un enseignant colombien du nom de Emefe11 (lettre complète dans l’Annexe 4) :
« J’ai eu la chance de voir en ma vie certains hommes éminent et de savoir, mais jamais je n’en ai vu comme Blanchard qui sache exposer ce qu’il sait avec autant de précision et d’élégance […] sa mémoire est une archive ; en lui la parole et l’idée sont fusionnées comme dans un accord de musique ; sa manière est un don de Dieu et non une faculté acquise […] Cet homme … me rappelle Abélard dans les célèbres discussions de la Sorbonne… »
Mais le malaise avec les spécialistes français de pathologie exotique est patent comme le montre l’absence de Blanchard lors de la création de la Société de Pathologie exotique par Laveran en 190812. Tous les gens qui comptent en France dans le domaine de la pathologie tropicale sont là : Chantemesse, professeur d’hygiène à la Faculté de médecine, collègue (et ennemi notoire de Blanchard à l’Institut lui-même), comme vice-président ; Giard, professeur à la Sorbonne depuis 1904 et Heim, que Blanchard était parvenu à faire évincer de la Faculté de médecine en 1897, tous deux membres titulaires ; Manson et Ross, pionniers anglais de la parasitologie tropicale et si admirés de Blanchard, comme membres honoraires. Bref, si Blanchard n’est pas présent à la naissance de cette société importante, - refus de sa part ou mise à l’écart par les fondateurs, - c’est probablement que le contentieux avec certains de ses pairs, notamment avec Laveran et avec Heim, n’est pas encore résolu. La défection de Blanchard ne durera toutefois pas puisqu’il est élu membre titulaire-honoraire de la Société à l’assemblée générale de la Société l’année suivante13.
L’enseignement colonial libre (1901-1905)
Cette entreprise fut initiée par Blanchard indépendamment de l’IMC. En fondant l'Institut, il avait eu l'ambition d'y annexer des cours et des démonstrations touchant les principales colonies françaises et passant en revue l'histoire, le climat, le sol, la flore, la faune, les races humaines, ainsi que les mœurs, langues, coutumes et maladies. Ce projet multidisciplinaire dépassait le cadre de la Faculté de médecine et s’adressait à un public élargi. On reconnait ici chez Blanchard l’ouverture d’esprit, le souci des cultures, l’éclectisme.
Soutenu financièrement par l’Union coloniale, il obtint le concours de conférenciers de spécialités variées, chaque année étant consacrée à une colonie : Madagascar en 1901, Tunisie en 1902, Maroc en 1904, Indochine en 1905. Chaque série comportait une quinzaine de conférences publiques et gratuites, Blanchard se réservant celles ayant trait à la zoologie et à l’hygiène des maladies. En raison de l’affluence aux premières conférences sur Madagascar, les conférences prirent place dans le grand amphithéâtre du Muséum d'histoire naturelle. Ensuite elles eurent lieu à l'ancienne Académie de médecine.
Les conférences eurent beaucoup de succès dans un premier temps mais elles coûtaient trop cher à l’Union coloniale. De plus, le succès d’affluence des premières années ne se confirma pas. Blanchard en donnera l’explication plus tard :
« Les auditeurs de la première série atteignirent les chiffres de 500 et 550. Mais l'œuvre suscita des imitations, qui eurent pour résultat d'éparpiller le public. II parut, la quatrième série, qu'on ne pouvait demander à des hommes de science, d'autre part très occupés, de venir parler dans un amphithéâtre insuffisamment rempli et c'est pourquoi les conférences ne furent pas continuées »14
Il en reste quand même deux volumes très documentés, correspondant aux deux premières séries, et dont Blanchard est l’éditeur.15.
Bilan de l’Institut
En 1911, Blanchard fait le bilan d’une décennie de fonctionnement de l’Institut16. Au moment où il écrit cette rétrospective, neuf promotions ont été formées. La division de l’enseignement est restée la même (voir plus haut) et Blanchard y dispense toujours ses 21 leçons de parasitologie, noyées dans un ensemble en 7 parties comprenant également la microbiologie, la pathologie exotique, l’hygiène, la dermatologie, l’ophtalmologie, la chirurgie. Aucune allusion n’est faite dans ce bilan à l’enseignement clinique à l’hôpital des dames françaises. On est amené à penser que ce fut une composante très faible, pour ne pas dire manquante, de cet enseignement. De même pour la recherche et les missions scientifiques destinées à étudier les maladies sur le terrain17.
L’Institut reste régi par un conseil d’administration ayant par principe comme président le Doyen de la Faculté de médecine et comme vice-président le doyen des professeurs participant à l’enseignement (probablement Chantemesse, qui dispensait toujours les cours d’hygiène du cursus en 1911). L’état financier est désespéré : en 1910 il ne reçoit plus aucune subvention extérieure ; il ne vit pratiquement que sur les droits de laboratoire qui s’élèvent à 130 F par élève.
Cette précarité n’a pas empêché l’IMC de former 279 élèves jusqu’à cette date de 1911, soit 27 en moyenne par session ; 224 ont obtenu le diplôme de Médecin colonial de l'Université de Paris ; 70 % d’entre eux sont étrangers, originaires de pays très divers, avec une nette prépondérance hispano-américaine notamment Colombienne et Vénézuélienne. Les Français diplômés sont des médecins civils. Leur diplôme leur confère d'office le titre de médecin sanitaire maritime, et quelques-uns d'entre eux prennent en effet du service dans l'administration sanitaire des ports ou auprès des compagnies de navigation. D'autres trouvent de bonnes situations aux colonies, auprès des compagnies minières, de colonisation, d'exploitation agricole. D'autres encore, notamment au Tonkin et en Afrique occidentale française, entrent au service de l'Assistance médicale indigène.
Par rapport aux autres formations de médecine tropicale, l’IMC avait donc acquis cette spécificité de former, de manière plutôt académique, des médecins majoritairement étrangers, ceci dans le cadre prestigieux de l’Université de Paris, avec des enseignants de valeur, mais sans chaire, sans direction véritable, sans clinique digne de ce nom, sans locaux ni moyens propres, sans véritable recherche de terrain. Sa durabilité reposait sur son défaut de constitution-même, à savoir sa dépendance étroite à quelques chaires d’enseignement, associées pour une cause commune. Sa pérennité était donc conditionnée à la stabilité des structures existantes, et finalement aux routines du fonctionnement universitaire.
La comparaison avec les grandes institutions anglaises de Londres et de Liverpool, que Blanchard prenait comme modèles, est sans appel, ceci sur tous les plans. L’un des déficits les plus frappants de l’IMC, au moins tant que Blanchard y sera présent, est la rareté des expéditions scientifiques dans les pays tropicaux, seul moyen de faire avancer la recherche sur l’épidémiologie et la pathologie des maladies parasitaires et vectorielles. Dans toute la période que nous étudions, rares sont les occasions où des membres de l’équipe de Blanchard ont pu être associés à des expéditions scientifiques. Quant à Blanchard lui-même, s’il s’est déplacé en Tunisie et en Algérie ce fut pour étudier les faunes locales en tant que naturaliste (et non pas parasitologiste). En revanche il n’a cessé de se déplacer en Europe dans les congrès de médecine et les réunions des nombreuses sociétés dont il était membre (voir le dernier chapitre de cette étude).
Dans ce bilan de 1911 Blanchard a évidemment conscience de tout cela et il lance un nouveau cri d’alarme, ressemblant en tout point à celui de 1907. Il rappelle pour la forme, - mais y croit-il encore ? -, les principes fondateurs, ceux d’un institut d’enseignement autonome à la mode anglaise, financé par souscription publique, promoteur d’une recherche ambitieuse incluant de nombreuses expéditions scientifiques.
Le type d’institut que Blanchard appelait de ses vœux ne verra pourtant jamais le jour à Paris ainsi que le montre un autre bilan fait 20 ans plus tard dans un Congrès sur l’enseignement colonial en France organisé pendant l’Exposition coloniale de 193118. L’IMC, - qui n’a finalement d’institut que le nom, - a alors le même statut et la même structure d’enseignement qu’en 1911. Il a peu de ressources propres mais cela est jugé « suffisant » (sic) par le directeur d’alors, auteur du rapport. La clinique est désormais rattachée à l’Hôpital Claude Bernard et c’est Brumpt qui a remplacé Blanchard pour l’enseignement des maladies parasitaires. On est frappé par l’accroissement du nombre des médecins formés : jusqu’à 60 par promotion. Sur les 1037 diplômés, 462 sont étrangers, soit 45%, ce qui indique que l’IMC a conservé une vocation internationale19. On notera enfin que le directeur de l’institut d’alors et auteur du rapport, un certain Louis Tanon, est hygiéniste donc nullement spécialiste des maladies tropicales.
R. Blanchard au microscope dans son laboratoire de la Faculté de médecine entouré de collègues et collaborateurs. Date et personnes non précisées.
(Source : Université de Paris.)
2 André CHANTEMESSE (1851-1919), élève de Louis Pasteur, il est nommé en 1897 professeur de pathologie expérimentale et comparée à la faculté de médecine de Paris et élu membre de l'Académie de médecine en 1901. Il fonde et dirige à partir de 1906↩
3 Robert WÜRTZ, Agrégé chef du labo de pathologie expérimentale de la faculté de médecine, puis en 1898 du labo d’hygiène. Il a publié en 1895 un précis de bactériologie clinique (qui a marqué son temps) et en 1904 un volume sur le diagnostic et la sémiologie des maladies tropicales (source Wikipédia).↩
4 BLANCHARD (1902). Rapport sur l’organisation de l’Institut de médecine coloniale. Arch. parasitol. 5 : 562-568. On ne trouve dans les nombreux écrits ultérieurs de Blanchard sur l’institut aucun rapport sur le fonctionnement de ce service réduit et sans continuité temporelle. On se figure aisément que l’enseignement clinique ne fut pas le point fort du cursus.↩
5 ANON. (1903) Tropical medicine in France. Brit. Med.J. 2: 1659 (26 décembre 1903).↩
6 Quinzaine Coloniale (25/12/1905) Création d’une chaire de médecine coloniale.↩
7Notes et informations (1907) Est-ce la fin de l’IMC ? 11 :534-536↩
8 Notes et informations (1908) Institut de médecine coloniale. 12:167-180↩
9 HECKEL Edouard et MANDINE Cyprien (1907) L’enseignement colonial en France et à l’étranger. Barlatier, Marseille. 197 p.↩
10 Rapport général du Congrès général colonial : en ligne sur BNF/Gallica pour les années 1905, 1905 et 1908. Composition de la 7e section : Président Blanchard (IMCP) ; Vice-président : Le Dantec (Bordeaux), Fontoynont, Jeanselme (IMCP) ; secrétaires : Brumpt (IMCP), Langeron (IMCP),↩
11 Notes et informations (1906) L’enseignement de la médecine coloniale. 10: 107-109.↩
12 Bull. Soc. Pathol. Exot. (1908) Séance du 28 janvier 1908. 1 : 1-26↩
13 Bull. Soc. Pathol. Exot (1909) Séance du 13 janvier 1909. 2 : 4-5↩
14 BLANCHARD (1908) Rapport des Titres et Travaux pp. 15-16↩
15 Madagascar au début du XXè siécle, 1902, F.R. de Rudeval, 256 p. - La Tunisie au début du XXè siècle, 1904, F.R. de Rudeval, 375 p.↩
16 BLANCHARD Raphaël (1911) Coup d’œil sur l’Institut de médecine coloniale (extrait des Archives de parasitologie). Hasselin et Houzeau. 20 p.↩
17 L’exception est la participation en 1902 de Emile Brumpt, élève de Blanchard, à l’expédition en Afrique équatoriale de Bourg de Rozas, pour l’étude du paludisme (voir Annexe D).↩
18 TANON Louis (1931) L’Institut de médecine coloniale de Paris. Exposition Coloniale Internationale de Paris 1931. Comptes rendus du congrès de l’enseignement colonial en France (28-29 septembre 1931). pp 1-5.↩
19 L’auteur du rapport précise qu’en 1920, au sortir de la guerre et après la mort de Blanchard, le montant des subventions était de 5000 F. Il n’avait donc pas augmenté depuis 1911 !↩